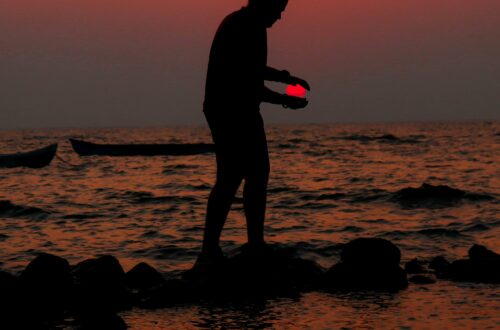Devenir créateur de sa guérison (Art thérapie partie 6)
Cet article s’inscrit dans la série consacrée à un thème essentiel : le rôle de l’art dans le processus de guérison.
Après avoir exploré la manière dont l’art redonne le souffle, nous abordons aujourd’hui une autre dimension : comment chacun peut intégrer la création dans sa vie quotidienne, au-delà même d’une séance d’art-thérapie.
La guérison ne se limite pas à un moment précis ni à un lieu spécialisé. Elle se construit dans la continuité, parfois dans les détails les plus anodins : une page de carnet, un air fredonné sous la douche, un geste laissé libre sur une feuille. L’art ne s’arrête pas aux murs d’un atelier : il peut devenir une présence discrète mais constante dans nos vies.
L’art comme prolongement du soin
L’art n’est pas seulement ce qui se vit dans l’atelier ou sous l’accompagnement d’un thérapeute. Il peut s’inviter dans les gestes les plus simples du quotidien.
Julie Morin l’explique : « Ce n’est pas l’art que l’on vient intégrer dans son quotidien lorsqu’on décide d’aller vers une thérapie par l’art, ce que l’on vient intégrer c’est la légèreté de l’expression et le lâcher-prise sur les situations parfois trop lourdes. On comprend qu’il existe d’autres moyens de s’apaiser. On comprend qu’il faut être à l’écoute de soi et si pendant ce moment de doute le besoin se fait sentir de reproduire ce qui a été fait en séance alors oui là on s’en saisit ! ».
En d’autres termes, il ne s’agit pas de devenir peintre, écrivain ou musicien. Il s’agit d’apprendre à créer des espaces de respiration, à introduire dans sa vie des moments d’expression où l’on dépose ce qui pèse trop.
Dans une société où le quotidien est saturé de contraintes, d’urgences et de sollicitations permanentes, cette légèreté devient une ressource rare. Créer, même cinq minutes, c’est s’accorder une parenthèse où l’on reprend contact avec soi.
Quand on croit ne pas être créatif
Beaucoup se disent : “Je ne suis pas doué, je ne suis pas créatif.” Mais l’art-thérapie n’est pas une question de talent. Julie Morin le rappelle : « Comme exposé au début de cet échange, si vous venez en séance pour acquérir des compétences créatives, alors vous n’êtes pas au bon endroit ! Encore une fois ce n’est pas de l’art en soi. On n’exige pas d’un clown de métier qu’il soit drôle dans la vraie vie pour faire rire un public de cirque, ici c’est pareil, on n’attend pas du sujet qu’il soit créatif pour venir se transformer. ».
La création n’est pas une performance. Elle est une ouverture, un mouvement. Laisser un trait s’échapper sur une feuille, tracer des mots au hasard, fredonner une note : tout cela suffit. Les enfants en sont la preuve éclatante : ils créent spontanément, sans se demander si leur dessin est “réussi”. Leur geste est authentique parce qu’il n’est pas contraint par l’idée de jugement. Retrouver cet élan premier, c’est renouer avec une liberté intérieure souvent oubliée.
Des exercices simples
Pour prolonger les bienfaits d’une séance, il est possible d’intégrer des exercices accessibles à tous. Julie en suggère quelques-uns : « Le plus grand exercice est déjà l’acceptation du silence, et du “rien”. J’en reviens aux anciennes traditions mais la méditation sur le néant est un exercice simple et salvateur, on peut y intégrer l’expression créative en prenant une feuille blanche et en faisant ce que l’on appelle le dessin neurographique ou encore l’écriture intuitive. ».
Ces pratiques ne demandent aucune technique. Elles rappellent que nous n’avons pas à “réussir” notre expression : seulement à la laisser advenir.
Le silence, le vide, le “rien” font souvent peur, mais ce sont eux qui ouvrent l’espace nécessaire à l’expression. Dans un monde où tout pousse à remplir — d’images, de sons, d’activités —, choisir de se confronter à une page blanche ou à un instant de silence devient un acte courageux et profondément libérateur.
J’ai moi-même découvert, au fil du temps, que l’écriture ne devait pas forcément mener à un texte construit. Parfois, griffonner des mots sans suite, écrire d’une traite sans se relire, suffisait à me libérer. C’est une manière d’accepter le désordre intérieur, de lui donner une forme au lieu de le refouler.
Créer, ce n’est pas bâtir une œuvre. C’est accepter d’ouvrir une fenêtre. Et cette fenêtre n’a pas besoin d’être spectaculaire : quelques lignes posées le soir, une mélodie improvisée au piano, un collage fait de morceaux de papier… Chaque geste compte, parce qu’il déplace quelque chose en nous.
Conclusion et ouverture
Devenir créateur de sa guérison, ce n’est pas apprendre une nouvelle discipline. C’est accepter que la création fasse partie de notre vie, comme une respiration, une ressource à portée de main. L’art-thérapie ne transforme pas tous ses pratiquants en artistes, mais elle révèle en chacun un espace de liberté. C’est ce pas de côté, cette légèreté retrouvée, qui fait naître peu à peu une guérison active et choisie.
Et vous, avez-vous déjà essayé d’intégrer un petit geste créatif dans votre quotidien, même en dehors de tout cadre artistique ?
Pour clôturer cette série thématique, nous nous demanderons dans le prochain article, « Et après ? Créer encore », quelle place cette pratique peut prendre dans le monde de demain, et pourquoi elle pourrait devenir une ressource essentielle dans nos sociétés. Et Julie Morin nous donnera quelques pistes pour l’avenir. Vous pouvez d’ailleurs la retrouver via son compte Instagram ou sur son site internet.