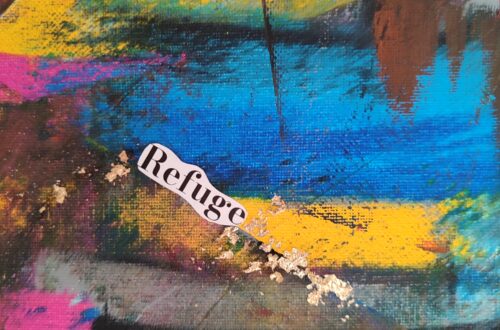Ce que l’art révèle en silence (Art thérapie partie 3)
Cet article s’inscrit dans la série consacrée à un thème essentiel : le rôle de l’art dans le processus de guérison.
Après avoir ouvert ce chemin avec mon propre témoignage, puis avec l’expérience de Julie Morin, art-thérapeute certifiée, nous poursuivons aujourd’hui notre exploration. Car au cœur de l’art-thérapie, il y a une idée simple et bouleversante : l’art dit ce que les mots taisent.
Quand les mots ne suffisent pas
Depuis toujours, nous nous appuyons sur le langage pour nous comprendre. Pourtant, chacun a fait l’expérience de ce moment où les mots s’effondrent : ils ne viennent pas, ou ils ne disent pas tout. La douleur est trop lourde, trop confuse. Les mots parfois réduisent, figent, trahissent.
Combien de fois gribouillons-nous machinalement sur un coin de feuille, fredonnons-nous une mélodie en marchant, ou laissons-nous notre corps bouger seul quand personne ne nous voit ? Ces gestes sont anodins en apparence, mais ils disent ce que nous ne savons pas toujours formuler. C’est ici que l’art prend le relais. Par un geste, une couleur, un rythme, il ouvre une brèche. Il touche là où le langage s’arrête, il donne forme à l’indicible.
Julie Morin le formule clairement : « Nous pensons à tort que le langage est une forme d’expression commune et universelle. Or depuis maintenant plusieurs années il a été montré et démontré que les mots ne sont plus les seuls à comprendre et soigner les maux. Le processus créatif quel qu’il soit apporte de l’aide et soulage celui en souffrance car il y a une forme de matérialisation de la vérité sous une forme plus douce, ainsi l’art encourage une transformation bénéfique de la situation de blocage en faisant appel au subconscient et à l’inconscient. ».
Ces mots résonnent comme une évidence : l’art devient ce langage parallèle, qui se faufile au-delà du mental et touche directement la vérité intérieure. En les lisant, je repense à mes propres débuts dans l’écriture. Adolescence heurtée, douleur tue. Les mots dits à voix haute restaient coincés, brouillés. Mais les mots écrits, eux, parvenaient à sortir. Ce que je n’osais pas confier, ce que je ne savais pas nommer, mes cahiers le recevaient. Ils portaient mes colères, mes peurs, mes désespoirs. Ils étaient la preuve silencieuse de ce que je vivais.
L’écriture n’était pas pour moi une activité littéraire : c’était un acte de survie. Exactement ce que Julie appelle une “matérialisation de la vérité” : une manière de sortir de moi ce qui, autrement, m’aurait englouti. Ce que Julie décrit comme une “matérialisation de la vérité” a toujours été pour moi le rôle de l’écriture : mettre au dehors ce qui m’aurait étouffé à l’intérieur.
Les ingrédients essentiels
L’art-thérapie ne se confond pas avec un simple atelier créatif. Ce n’est pas un espace où l’on cherche à progresser techniquement ou à produire une œuvre à montrer. Sa force tient justement à l’absence d’attente esthétique.
Julie insiste sur ce point : « L’art thérapeutique doit pouvoir se priver de la notion de “beau”. J’explique, nous n’attendons pas un résultat esthétique ou technique ni même un résultat tout court. Le premier ingrédient est là : le NON RÉSULTAT, ce qui compte c’est le processus créatif. Pour que l’art soit thérapeutique il doit différer d’un atelier créatif, on ne forme pas des artistes ! Quand aux autres ingrédients, chaque thérapeute met son cadre thérapeutique qui permettra d’inviter le sujet à l’expression artistique dans un sens de réparation. ».
Cette idée du “non-résultat” est libératrice : elle permet de créer sans la peur de l’échec, sans la pression du jugement. Le geste devient plus important que l’œuvre, l’élan plus essentiel que le produit final.
L’universalité de la création
Faut-il écrire, peindre, chanter, danser ? Peu importe le médium choisi : chacun emprunte un chemin différent, mais tous visent une libération semblable. Julie l’affirme : « Je dirais qu’il y a une dimension universelle, celle de se libérer à l’aide d’un médium qui sera la continuité de l’expression. Ainsi celui qui choisit d’écrire pour se libérer est sur le même chemin que celui qui choisit de mettre ses émotions en couleur, ou celui qui danse sa douleur. ».
Ce lien invisible entre toutes les formes d’art rappelle que nous sommes tous créateurs à notre manière, même sans le savoir. Derrière chaque gribouillage, chaque chanson murmurée, chaque pas esquissé, se cache une tentative d’expression et parfois, une guérison discrète.
Conclusion et ouverture
L’art révèle en silence ce que nous n’osons pas dire. Il ne juge pas, ne corrige pas, ne cherche pas le beau. Il accueille, il dépose, il transforme. Il ne promet pas de miracles immédiats, mais il ouvre une voie : celle d’un chemin intérieur où l’on peut se rencontrer enfin, sans masque.
Et vous, avez-vous déjà trouvé dans la création un moyen d’exprimer ce que vous ne pouviez pas dire autrement ?
Dans le prochain article, « Dans l’atelier des émotions », nous plongerons au cœur d’une séance d’art-thérapie : comment elle se déroule, quels rituels la structurent, et quels mécanismes psychologiques et émotionnels elle met en mouvement. Julie Morin nous éclairera encore de son regard d’experte et de praticienne. Vous pouvez d’ailleurs la retrouver via son compte Instagram ou sur son site internet.